Un peu par hasard, j’ai lu Paradis, de l’écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah.
Je ne savais rien de cet homme, ni de ce roman.
L’histoire d’un enfant prénommé Yusuf, en Afrique de l’Est, dans les années 30, vendu subitement par son père à un riche commerçant, « Oncle Aziz ».
Yusuf ne comprend pas pourquoi on l’arrache à son village, à sa mère, à sa paisible pauvreté. Il doit désormais servir cet intimidant Oncle Aziz, qui n’est même pas son oncle. Comme l’enfant, on suit, on observe, on écoute. Paysages d’une Afrique souvent hostile – forêts infestées, rivières infranchissables, montagne éreintante, attaques animales, végétales, humaines. Défilé de dégaines pittoresques, – enfants esclaves, commerçants véreux, porteurs malmenés, mendiants, trafiquants de cornes, d’or, de peaux et de bois précieux, sultans et chefs de villages. Une société d’Arabes, d’Indiens, de Perses, d’Omanais. Les Blancs, c’est-à-dire les colons allemands, arrivent tout juste dans la région.
Chacun parle sa langue, quelques-uns servent d’interprète. Chacun prie son Dieu mais qu’on soit musulman, chrétien converti ou animiste, la ferveur religieuse est syncrétiste, bricolée de croyances païennes.
Il y a du beau, du drôle, de l’étonnant dans toute vie, presque toute. Gurnah sait montrer ça, et cette nuance – ah, la nuance ! – lui évite de peindre une caricature, au profit d’un récit vraisemblable et d’autant plus poignant. Le malheureux Yusuf, effrayé mais courageux, s’adapte, s’accroche, et attrape la beauté et la joie quand elles passent à sa portée. Etre joli garçon ne lui simplifie pas la vie : on le moque, on le jalouse, de vieilles folles le harcèlent. D’une épreuve à l’autre, il comprend, devine, se dessille : son père, qu’il ne reverra jamais, l’a vendu pour éponger ses dettes, et cela arrive à bien d’autres.
Oncle Aziz, ancêtre des Voyageurs Représentants Placiers, embarque Yusuf dans d’épiques tournées commerciales, au fin fond du pays. Une expédition prend des mois, des années. Les marchandises sont souvent volées, offertes en échange de protection ou réquisitionnées par d’obscures autorités… Les déconvenues s’accumulent, Oncle Aziz vieillit, le climat se tend. Le gamin devenu adulte a les yeux bien ouverts sur la cruauté de sa situation, la banalité de cette cruauté.
Après avoir enduré mille peines avec noblesse, alors que les colons s’installent, Yusuf a l’occasion de les fuir, mais il choisit subitement de s’engager à leur service.
Choisit, ou opte pour le moins pire ? Fier ou honteux ? On ne sait pas.
Pour une Française vivant en France (indice), c’est un texte exotique, au sens le plus noble du terme. Il s’agit d’un ailleurs, dans le temps et l’espace, où la vie, brève et brutale, ne vaut pas cher. Pourtant le ton est doux, le balancement des phrases et les descriptions simples, parfois naïves, font souffler le vent tiède des contes et légendes, – mais on sait que les contes sont pleins de meurtres et de monstres.
Je referme le livre, attentive à l’onde vibratoire qui s’enclenche alors – ou pas -, le soir même, le lendemain, plus tard encore parfois. La caravane tranquille des mots de Gurnah fait son chemin hors des pages, gagne mon cœur, et soudain le titre, Paradis, prend tout son sens : il s’agit de l’enfance, des lieux quittés jamais retrouvés, des lieux rêvés, de la force qu’on rêve d’avoir face aux ennemis de tout poil, de la dignité qu’on se promet, enfant, de conserver toujours.
C’est un Africain qui parle d’Afrique, oui, mais c’est d’abord un écrivain. Les hommes dont il parle ressemblent à tant d’autres, n’importe où ailleurs. Violents et agressifs, rusés et drôles, tendres par exception, démunis le plus souvent, luttant pour survivre.
C’est un Africain qui parle aussi, un peu, des colons. Les Blancs remanient profondément les règles de vie, notamment parce qu’ils interdisent l’esclavage alors pratiqué assidûment. C’est même une des rares choses qui soient dites à leur sujet, dans les trois brefs dialogues qui mentionnent les Allemands.
Gurnah ne décerne aucun prix d’inhumanité, ni d’humanité, à quiconque. Si je m’en tiens à son texte, les pratiques en place (esclavage, trafic de marchandises, d’animaux, d’enfants et de femmes, violence) ne sont pas plus heureuses que celles instaurées par les colons. Mais les colons disposent, c’est vrai, d’une puissance dissuasive pour préempter et régenter un pays qui n’est pas le leur.
Sur le Net, j’apprends que Gurnah a reçu le prix Nobel de Littérature en 2021.
Wikipédia, encyclopédie gratuite collaborative, centre sa présentation de l’œuvre ainsi :
« Dans son roman Paradis, l’auteur va dénoncer l’accaparement des terres africaines par les européens durant la colonisation. Par exemple, il fera dire à l’un de ses personnages page 109 (édition Denoël) : « Regarde comment ils se sont déjà partagé les meilleures terres de la montagne. Au nord, ils ont réussi à chasser les habitants les plus farouches, qui se sont laissés faire comme des moutons, et ils ont enterré vivants quelques-uns de leurs chefs. Tu ne savais pas ça ? Les seuls à qui ils ont permis de rester, c’était pour en faire leurs domestiques. On ne peut pas lutter contre leurs armes et c’est comme ça qu’ils s’approprient les terres. Tu trouves que ça ressemble à une simple visite ? Je te dis qu’ils sont déterminés. Ils convoitent le monde entier ».
C’est en effet un des trois dialogues évoquant les colons, mais est-il emblématique du roman ? le résume-t-il ? Je n’ai pas lu un livre sur la colonisation européenne de ce coin d’Afrique, mais un roman sur une terre soumise, de tous temps, à une succession de dominations étrangères.
Par exemple (p 163), dans une discussion entre plusieurs personnages du roman :
« – Peu de temps après le départ d’Amir Pacha est arrivé Prinzi, le commandant allemand ; il a livré bataille au sultan, l’a tué lui, ses enfants et les membres de sa famille. Les Arabes ont été contraints de se soumettre, et humiliés à un tel point qu’ils ne pouvaient plus forcer leurs esclaves à travailler dans les champs ; ils se cachaient ou se sauvaient. N’ayant plus rien à manger, les Arabes n’ont pas eu le choix et ont du partir. Il y en a qui sont allés à Ruemba, d’autres en Ouganda, ou qui se sont réfugiés chez leur sultan à Zanzibar. A présent, ce sont les Indiens qui leur ont succédé, les Allemands sont leurs Seigneurs et les sauvages leurs esclaves.
Il ne faut jamais se fier à un Indien, déclara Mohamed Abdalla avec aigreur. Il vendrait sa propre mère s’il y trouvait avantage. Sa cupidité est sans limites. Il parait faible comme ça, et poltron, mais il a tous les courages quand il s’agit de gagner de l’argent.
Oncle Aziz secoua la tête, il désapprouvait la véhémence du mnyapara. « Les Indiens savent comment s’y prendre avec les Européens. Nous n’avons pas d’autre choix que de collaborer avec eux. »
Plus loin, page 199, un dialogue entre un autochtone, et un colon, sollicité pour arbitrer un contentieux commercial entre Oncle Aziz et un certain Chatu :
« – Alors Chatu, tu t’imagines que tu es devenu un grand chef ? Et tu dépouilles les gens de leurs biens ? Tu ne crains pas la loi du gouvernement ? De quel gouvernement parlez-vous ? cria le sultan.
Tu ferais mieux de baisser le ton, mon ami. Tu ne sais pas qu’il existe d’autres gueulards de ton espèce que le gouvernement a fait taire et enchaîner ? dit l’interprète.
Nyundo traduisit d’une voix triomphante ces paroles, qui suscitèrent les acclamations de ses compagnons.
Il est venu pour chercher des esclaves ? demanda Chatu d’un ton furieux.
L’Européen répliqua avec irritation : « Mon gouvernement ne fait pas le commerce d’esclaves, c’est vous autres qui en achetiez, et nous sommes venus pour mettre fin à ce trafic. Rends leurs marchandises à ces gens, sinon tu t’en repentiras. »
Précisons que l’Européen donnera raison à l’oncle Aziz, qui jubilera de récupérer ses marchandises.
Babelio, site de partage d’avis de lecteurs anonymes, se contente de reprendre la présentation de l’éditeur français (Denoël) :
« Quand ses parents annoncent à Yusuf, douze ans, qu’il va partir séjourner quelque temps chez son oncle Aziz, il est enchanté. (…) Il ne comprend pas tout de suite que son père l’a vendu afin de rembourser une dette trop lourde – et qu’Aziz n’est pas son oncle, mais un riche marchand qui a besoin d’un esclave de plus chez lui.
À travers les yeux de Yusuf, l’Afrique de l’Est au début du XXᵉ siècle, minée par la colonisation, se révèle dans toute sa beauté et sa rudesse. (…) »
« Une Afrique minée par la colonisation » : comme s’il fallait ajouter cela au résumé (un enfant (africain) est vendu comme esclave par son père à un faux oncle (africain)).
Sur le site des librairies du réseau FNAC :
« A. Gurnah est un écrivain tanzanien et un universitaire spécialisé dans les études postcoloniales. Connu pour son roman Paradise, l’auteur s’inspire de son histoire personnelle pour réfléchir aux thématiques liées à l’exil. »
Gurnah a en effet quitté la Tanzanie (devenue indépendante en 1961) quand lui-même a 20 ans, en 1968, souhaitant étudier en Angleterre. Il y est devenu professeur, ainsi qu’écrivain, peu traduit en France et donc peu connu avant son Nobel. Ses autres livres parlent notamment de migration et d’exil, -ce qui est distinct de la colonisation -, mais ce n’est pas le sujet de Paradise.
L’Académie Nobel a officiellement indiqué le récompenser pour son « analyse sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés écartelés entre cultures et continents ».
L’article du Monde, le 12 décembre 2021, publié à l’occasion du prix, rappelle à son tour et avant tout la motivation du jury : ce qui est récompensé, c’est son analyse du colonialisme.
Je me disais, c’est bizarre, non ?
On dirait que l’Académie Nobel a voulu récompenser les études universitaires de Gurnah – mais alors c’est un autre prix qu’il fallait lui remettre – plutôt que ses romans.
Peu de commentaires sur son style, les dialogues, les récits de voyage à l’intérieur du récit, les descriptions physiques sans concession. Peu de commentaire sur ce tout dernier mouvement, mystérieux, du jeune Yusuf : rejoindre les colons.
Il faut fouiller dans les revues littéraires confidentielles (par ex. Trans, revue de littérature générale et comparée) pour s’éloigner des clichés, et trouver des informations intéressantes sur la façon dont Gurnah incorpore des récits traditionnels swahilis, quasi mythologiques, à son texte. Récits de voyages de tradition orale dont on doit d’ailleurs le recueil et la transcription, au tout début du 20ème siècle, à … des voyageurs allemands.
A part quelques exceptions, c’est comme si journalistes et critiques ne savaient plus lire.
Car lire, ce n’est pas projeter sur une page ce qu’on croit savoir d’un texte, ce qu’on voudrait qu’il soit. Ce n’est pas étouffer les mots et les nuances du texte sous le résumé que tel ou tel nous aura fait.
Lire, ça devrait se passer exclusivement entre le texte en question et soi-même.
Laisser nos yeux déchiffrer, puis notre cerveau traduire, piger, visualiser, ressentir, imaginer, entendre. Dévorer trois pages puis soudain revenir à telle phrase, pour le plaisir, pour vérifier – ô seconde lecture rapide, presque inconsciente, quelques lignes en amont, le pouce entre les pages pour vite reprendre le fil !
Lire c’est s’installer dans le registre de l’auteur, y naviguer, qu’il soit banal ou innovant, guindé ou familier, mélangé ou monochrome. Le registre ! Tout à la fois timbre de voix, élocution et accent, déterminant pour se figurer le monde dans lequel on entre.
Se sentir subitement l’ami ou l’ennemi intime de l’auteur -ou du héros-, à cause d’un mot, de deux mots associés, d’un espace entre deux paragraphes, d’un silence dans un dialogue.
Féconder le texte de notre sensibilité, nos expériences, nos fondamentaux, nos lacunes, en faire malgré soi une traduction unique, changeante d’un lecteur à l’autre.
Et que tout cela ait lieu à partir des mots de l’auteur, rien que ses mots, mais tous ses mots. Nuances incluses.
Rosalie NISS
Ouvrage cité :
Paradis, d’A. Gurnah. (Denoël), 1994
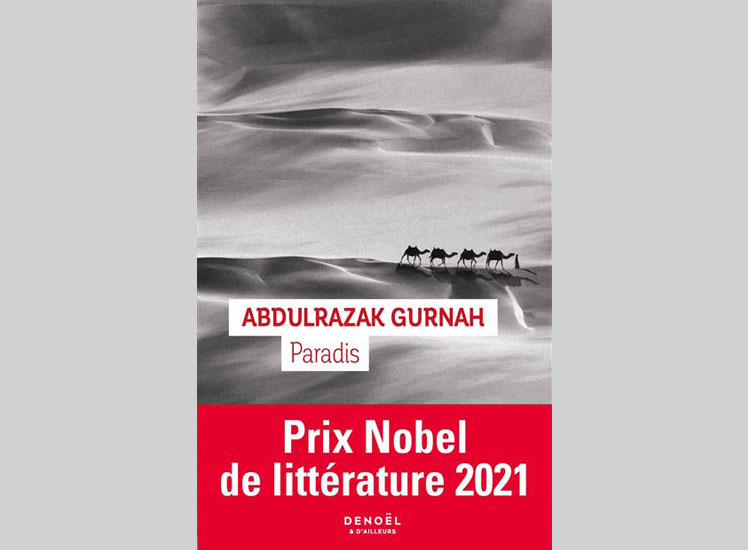
Laisser un commentaire