A première lecture, c’est un texte original et mystérieux. Une histoire qui navigue d’un réalisme parfois sordide à un monde fantastique/ fantasmé, où tout ne sera pas élucidé.
Une jeune femme, Fauvel – pourquoi pas, beau prénom à connotation animale -, désoeuvrée, angoissée, borgne à cause d’un tir de LBD, vient s’installer à la campagne pour garder une chienne dont le propriétaire part en voyage.
Fauvel n’aime pas spécialement les chiens, et celui-ci est particulier : c’est une chienne clonée à partir d’une autre, morte, dont le corps empaillé trône dans le salon de la maison.
C’est l’automne, Fauvel promène la chienne dans une campagne brouillardeuse et hostile, croise des chasseurs, s’en inquiète. Elle perd la chienne, la retrouve, s’égare dans les chemins à ronces, craint une balle perdue… C’est une campagne française déshéritée, dont les rares emplois sont offerts par une usine de traitement de la source d’eau locale.
Il y a Julien, un gars un peu paumé qui confie avoir été colonisé par des créatures extra-terrestres. Son récit tremblant, hyper crédible car maladroitement poétique, plein de honte et de trébuchements, installe un suspens mêlé de pathologie et de misère sociale.
Il y a Michel, un thésard homo qui s’intéresse justement aux phénomènes paranormaux.
Il y a ces évènements étranges et morbides : des animaux sont mutilés, la chienne clonée disparaît puis réapparaît, parfois blessée, parfois les babines pleines de sang. La terre, les feuilles, les bêtes se couvrent de « filaments sporigènes », blanchâtres, visqueux, d’origine inconnue. (On apprendra que c’est lié à la pollution de l’eau.)
Il y a cette connivence qui finit par éclore avec la chienne, dont Fauvel « sent dans son crâne l’interminable et sympathique babil, qu’elle ne peut pas tout à fait déchiffrer encore mais qui la traverse comme une rivière généreuse ».
On embarque volontiers dans cette exploration nerveuse et à tâtons, qui mêle intelligemment les registres. L’écriture a un phrasé énergique, un swing tricoté de poésie classique et d’expressions crues, d’un vocabulaire précis et de néologismes à la mode.
Composition foutraque, sensible et déroutante, déroutée, comme Fauvel.
D’une contemplation de la campagne, de nuit en voiture : « un univers qui se limite aux talus blanchis, qui remonte le long des parois de la voûte dessinée par les phares, c’est un arc, une porte qu’elle franchit sans cesse. », à cette formulation de la peur : « Fauvel sent tous ses organes migrer momentanément vers son cul. »
Car Fauvel vit dans la peur ; c’est dit et redit, souligné par l’éditeur.
Mais la peur de quoi, de qui ?
Malmenée enfant par le jules de sa mère, régulièrement emmerdée par des types lourds, puis éborgnée par un tir de LBD dans une manif, Fauvel a son compte. On compatit.
C’est intéressant, la peur, l’inquiétude fondamentale. On devine l’ébranlement, le choc de cette mutilation, on aimerait en savoir plus. Mais l’auteur se contente de notations censées nous suffire, de fausses évidences socio-politiques, comme des balises de bien-pensance.
Fauvel fume des pétards, glande beaucoup, est végétarienne. On est censé en déduire quoi ? Qu’on est dans un univers cool ? Jeune et woke ? Banal. Voyons ce que l’auteur a à dire, à part ça.
N’ayant aucun a priori sur Hadjimarkos Clarke dont je ne savais rien, j’ai lu ces notations avec un léger agacement, sans m’y attarder. Elles n’ont pas empêché mon intérêt global pour l’histoire et son écriture, malgré une petite butée d’enthousiasme.
Une fois de plus, les critiques élogieuses du Monde/ Inrocks/ Télérama, celles du jury du prix Inter (dont elle est la lauréate 2024) ont souligné le moins intéressant du livre – voire le plus dommageable : son fond idéologique.
Les Inrocks s’empressent de le préciser :
« Phœbe Hadjimarkos Clarke, autrice franco-américaine qui a publié son premier roman Tabor au sein de la petite maison d’édition engagée Le Sabot, est classée par les lecteur·rices et libraires du côté de la science-fiction queer. Queer fait allusion à ses personnages LGBTQI+ »
(« Notez bien, hein, puisqu’il semble que ce soit ça l’important…)
Les Inrocks poursuivent :
« (…) Toute cette imagerie, extraterrestre comme magique, se fait le reflet et la métaphore de peurs bien plus actuelles : les violences policières, qui ont coûté un œil à la protagoniste, les violences masculinistes, dont le mystérieux personnage de Julien avec sa musculature impressionnante et presque animale est le principal représentant, et les violences du dérèglement climatique – l’eau ne cesse d’être un enjeu dans cette ville qui abrite la bruyante usine d’eau minérale. »
Ahhhh, nous y voilà. Le nouveau point Godwin : les violences policières et masculinistes. La violence policière et masculiniste !! – sans compter les « violences du dérèglement climatique » (salaud de climat).
Le Monde enfonce le clou :
« Un roman qui vient tout droit de notre époque. En fournit la preuve la liste de sujets contemporains abordés : les « gilets jaunes », le genre et l’identité, la question animale, la sixième extinction de masse, les sécheresses estivales… »
Ah bon, les Gilets jaunes ?
J’ai rouvert le roman. Ces deux mots en sont absents.
En revanche, à seconde lecture, les notations agaçantes ont pris tout leur relief : elles dessinent la limite du talent d’Hadjimarkos Clarke. Un talent soumis aux poncifs, au starter-pack « jeune de gauche », qui bourre le texte de déclarations de navrante conformité. Voilà où butait mon enthousiasme.
Reprenons notre résumé en incluant les fameuses notations crispantes :
Fauvel a été malmenée et insultée par un beau-père. Pas violée, mais humiliée, méprisée, mise mal à l’aise, sans l’aide d’une mère qu’on devine défaillante.
« La peur n’a jamais été absente, dès l’enfance. Serpentine elle a pris la forme d’une méfiance s’enroulant de tous côtés, pénétrant les interstices, quelque chose qui signifiait que son corps, aux yeux des autres, n’était peut-être pas aussi précieux qu’elle l’aurait espéré ».
C’est joliment dit pour un triste malaise adolescent, inévitable dans une famille d’irresponsables. Mais il y a là un faux truisme à la noix : un seul beau-père vous emmerde et tous les hommes sont des ordures. Lorsqu’un garçon aborde Fauvel, c’est forcément un emmerdement, car les types « elle les connaît tous, elle les voit venir d’ici ».
Ah bon.
Ça doit être aussi pour ça que Fauvel redoute d’emblée les chasseurs, dont elle ne sait rien sauf ce que lui ont dit ses copains militants ultra-écolos, qui ne distinguent pas une vache d’un cochon : « des gros types bourrés et myopes rôdant derrière les buissons ».
Ces ploucs, note Fauvel, peuvent pourtant être « beaux à leur manière ». Hé hé. Malgré sa hideur sociologique, la virilité de Julien trouble parfois Fauvel :
« Il est campé les jambes écartées, la crosse de son fusil bat contre les cuisses fantasmées que l’on devine, même à travers le tissu épais du treillis, à la fois musclées et grasses, probablement boutonneuses sous les poils blondins. »
Il est même fantasmé : « Erotique chasseur nocturne », « loup solitaire muscu-faf qui va faire des tueries ».
Ahhh… nous y sommes ! Le pauvre type de la campagne, chasseur et taiseux, c’est forcément « un muscu-faf » : l’horreur. Je rappelle : « Faf » pour «France aux Français ». Alors « muscu-faf »…tremblez ! La peste brune ! Le retour de ! Castors, à l’aide !
Un homme blanc (sinon ça serait différent, on lui pardonnerait sa virilité même la plus terrifiante), hétéro (sinon ça serait pas pareil, on lui pardonnerait ses turpitudes même les plus voyantes), un gars du terroir, gourmette et maison à tomettes : triple beurk, nous dit la gauche et mieux : l’ultra-gauche.
C’est bizarre, ai-je pensé, ça me rappelle ces « féministes » si soucieuses de respecter l’Autre (i.e. premier métèque venu), et si intolérantes avec les types parmi lesquels elles ont grandi. Jamais elles n’imaginent que les gros bourrins blancs aient peur. Eux aussi. Peur de souffrir, d’être largués, rejetés, de rien comprendre, de se faire doubler, de pas bander. D’être remplacés.
Il y a ce tir de LBD qui a éborgné Fauvel, événement dont je mesure la portée dramatique, douloureuse, physique et morale. Justement, ça aurait mérité qu’on en sache plus. A part le contexte d’une manif, on ne sait rien – comme si c’était suffisant, évident pour chacun. C’est d’ailleurs ce que fait Le Monde : LBD + Manif = Gilets jaunes.
Fascinant comme certains journalistes écrivent entre les lignes d’un roman ce qu’ils voudraient y voir.
Ce n’est pas rien, ces deux mots : Gilets jaunes. Ils désignent un mouvement populaire (noble mot), né fin 2018, spontané, douloureux, émanant de ceux qui ne protestent jamais. C’est parti du prix de l’essence (d’où le symbole du gilet fluo présent dans chaque voiture), d’un message posté sur Facebook par Jacline Mouraud, (quinqua du Morbihan, accordéoniste pour bals musette et agent de sécurité incendie pour boucler les fins de mois). Son interpellation du gouvernement sur la gestion économique du pays était devenue virale, ça avait débuté comme ça (comme dirait Bardamu).
Les Gilets jaunes étaient des Français de province au boulot utile, concret, exempt de télétravail : infirmières, instits, chauffeurs routiers, serveurs, cuistots, agents de mairie, petits commerçants, artisans, assistantes maternelles… Flics et gendarmes auraient pu en être, s’ils avaient le droit de manifester. Souvent peu politisés a priori, ils ont occupé le rond-point de leur bourgade pendant que la belle-mère gardait les gosses, puis ont débarqué à Paris, en voiture, en autocar, pour manifester poliment. Dire qu’ils n’y arrivaient plus, malgré toute leur loyauté Un peu paumés, bravement joyeux, en K-way et doudounes – je le sais, j’y étais, et personne n’a pris de LBD.
A ne pas confondre avec ceux qui sont arrivés ensuite pour infiltrer et dénaturer ces manifs : immigrés et Français issus de l’immigration, arrivés de banlieue en Rer, capuches noires et baskets, pleins d’une agressive revendication générique (ceci n’est pas un avis, c’est un constat, cf n’importe quelle image d’archive) ; Français « blancs » urbains, lycéens ou étudiants, voire profs, militants politiques d’ultra-gauche formant les « Black block » (ceci n’est pas un avis, c’est un constat, cf n’importe quelle image d’archive). Décidés à tout péter, tout piller, tout conchier. Certains Gilets jaunes ont accepté cette association, la plupart ont compris qu’ils s’étaient fait avoir, et les flics ont reçu la triste consigne, là oui, de réprimer durement, et notamment au LBD. Et ce sont les Gilets jaunes, eux et non les autres, qui ont payé chèrement de leur audace (parmi les éborgnés, H Bahrini, formateur en maroquinerie, D Breidenstein, scieur d’acier, V Langard, auxiliaire de vie, etc.)
Je ne vois pas Fauvel parmi les « vrais » Gilets jaunes : elle ne bosse pas (et s’en vante quasiment), ne fait pas d’études, et se carre du prix de l’essence.
Je la vois plutôt avec les contestataires semi-pros. Sur une Zad. A Sainte-Soline. Contre un projet d’autoroute ou autre cause « écologiste », même si elle se vante de ne rien connaître à « la nature » : en temps normal elle s’endort « au milieu de dix mille rues, de dix mille routes… écoutant d’une oreille les chuchotements de son appli de méditation.. ».
Je la vois dans ces manifs qui se passent d’autorisation, et bravent l’interdiction : « Fauvel et tous les autres ont continué à sortir dans les rues, à courir, marcher, pleurer dans les rues, pour conjurer la terreur, les cauchemars, ne pas les laisser vaincre. Tous ensemble à gueuler dans la rue, au milieu des voitures de flics et des chiens mortels. ».
Peu importe la cause, on s’en fout, ce qu’on aime c’est se faire peur. Ce sont ces cortèges du camp du Bien qui attaquent les flics à coups de pavés et de cocktails molotov, crament leurs véhicules même quand ils sont dedans : comme chacun sait, les blessures de flics ça compte pas, puisqu’ils ne sont pas des vrais gens.
Fauvel aime aussi beaucoup se « mettre des doigts dans le cul », ou un godemiché apporté dans ses bagages.
Le vagin c’est bourgeois, c’est cisgenre, c’est naze. Le plug anal, inspiré des pratiques homos, transgenres, c’est intersexe, gender fluid, so cool.
Mais c’est encore trop sexuel pour Fauvel :
« elle aurait presque envie que ça se passe autrement, ailleurs, ce serait la suite logique du processus qu’elle a déjà enclenché. Elle a commencé par ne plus coucher avec d’autres personnes, puis à n’utiliser que son anus, ou, à la rigueur, sa bouche, seule. (…) Ça vient sûrement de plus loin, d’une détestation de son sexe ou d’une pitié pour lui, d’un désir immense de solitude, peut-être mal placé. »
Mais oui, arrêtons les hommes, le sexe avec l’autre genre, les échanges corporels, la reproduction, arrêtons de faire des enfants, arrêtons l’espèce, tout est foutu, pollué. Finissons en tête à tête – si je puis dire – avec notre trou de balle.
Comme dirait Louis-René Des Forêts :
« Refus de renouvellement dont le fin mot, sous couvert de la sagesse, n’est au vrai qu’un conformisme mental et chez nombre d’entre eux qu’une incurable sclérose. »
Enfin et surtout, Fauvel aime fumer des pétards (oui, elle coche toutes les cases).
Fumer de l’herbe c’est son « péché mignon par temps d’oisiveté, auquel elle a recours de plus en plus souvent ». Vraiment souvent, même si « il est encore un peu tôt et elle est encore sous le coup de la fume intense de la veille, un peu vaseuse mais sûre de vouloir fumer à nouveau ». Tout l’argot de la fumette y passe : Oinj, zder, bad et autres mots si rigolos. Mais les (nombreuses) scènes de « trip » sont comme les récits de rêves dans n’importe quel roman : chiantes. Une sous-fiction pâlichonne, qui ne prend pas. On se dit qu’elle ferait mieux de se demander, Fauvel, quel trafic elle entretient avec le pognon de son herbe, quelle engeance elle nourrit, combien de kalachs et de faux passeports elle a aidé à financer. Mais Fauvel est cool, elle ne se pose pas de questions de réacs, elle ne se pose pas de questions du tout.
Elle finit par admettre comme par inadvertance : « la conscience de l’origine de la parano (la fume) n’aide pas à l’atténuer.»
C’est honnête. La fumette rend con, en effet, sinon Fauvel réaliserait peut-être à quel point sa peur est entretenue, téléguidée, formatée. A quel point ses a priori sont sommaires, comme elle est peu curieuse de les sonder.
A la solitude du doute, au risque de la lucidité, elle préfère appartenir à la meute des victimes certaines de l’être, au troupeau des gentils-contre-les méchants, poussés dans le dos par l’air du temps, par sa créatrice.
« Un roman qui vient tout droit de notre époque », dit Le Monde. Ah bon ?
Je regarde autour de moi, en ville, en campagne, en banlieue.
« Il faut toujours dire ce que l’on voit ; surtout-il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit. », a écrit Peguy.
C’est pas gagné pour Phoebe Hadjimarkos Clarke. Elle écrit bien, mais elle y voit mal.
Ouvrages cités :
Aliène, de Phoebe Hadjimarkos Clarke (éditions du Sous-sol, 2024)
Ostinato, de Louis-René Des Forêts (L’imaginaire Gallimard, 1997)
Notre jeunesse, Charles Péguy (1910, Poche Folio Essais 1993)
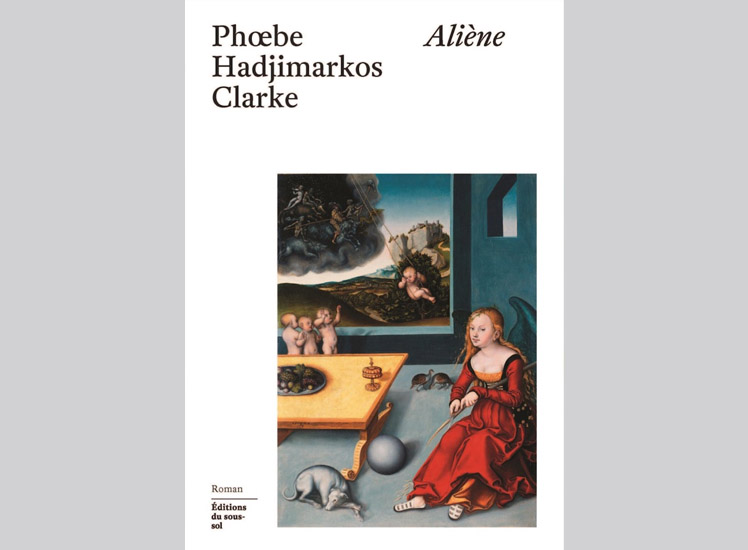
Laisser un commentaire