Explorons d’abord le texte, tenons-nous en aux mots imprimés, soigneusement choisis par l’auteur.
Ensuite seulement, on causera de qui il est.
Imaginez que dans un avion américain, en « business class », votre voisin en costard chic vous raconte sa vie. Le type est sympathique, bon sourire franc, belle voix, mais n’abuse pas de son charme. Son récit est naturel et plein d’humour. On le devine homme d’affaires, il l’est, et aussi avocat, et pas des moindres. Mais il n’oublie jamais d’où il vient : d’une famille dysfonctionnelle, typique d’une région déshéritée des USA : les Appalaches, l’Ohio. Il est né parmi ceux qu’on appelle les « rednecks » ou les « hillbillys » : les ploucs, les petits blancs, les crétins des montagnes. Il a peu vu son père et côtoyé une myriade de beaux-pères, pour le meilleur et souvent le pire. Il connait par cœur la spirale des violences familiales, de la pauvreté matérielle, culturelle, relationnelle, entraînant drogue ou addiction aux médicaments, petits boulots vite lâchés, amertume, divorces à répétition, violences etc. Une spirale inéluctable.
Ou presque : puisque lui s’en est sorti.
Marine pendant 4 ans pour parfaire une éducation très incomplète – c’est lui qui le dit -, il a ensuite intégré l’université, puis l’école de droit de Yale, pour devenir avocat.
Il a changé de monde, intégré d’autres codes, sans rien renier ni rien oublier.
Une exception éclatante, à laquelle il ne cesse de réfléchir : à quoi le doit-il ? à qui ? Pourquoi la grande majorité des « siens » reste dans la mouise, et pas lui ?
On sait pourquoi : parce que, comme toujours, parmi la galerie de parents défaillants il s’est trouvé ici une grand-mère, là un prof ou une demi-sœur qui a été présent au bon moment. Qui a prononcé la bonne phrase, donné un conseil pour une fois utile, prêté quatre sous, eu un geste de tendresse. Ça peut suffire. A créer un espoir, un champ de possibles, à passer un cap.
Le type baisse d’un ton, car il réfléchit en même temps qu’il parle, et vous comprenez qu’il n’éludera rien de ce qu’il a vécu, même le moche, l’ambivalent, le décevant. Pas de mythologie ni de vision binaire pour lui, pas de martyrs ni de fatalité, il veut creuser, comprendre.
Sa grand-mère fait partie de ceux qui l’ont sauvé. Elle était violente, armée, ordurière, complètement barge mais aimante, protectrice à sa façon. Surtout, – et il ajoute ce détail fondamental : elle a été capable de l’engueuler, et de le mettre devant sa part de responsabilité.
C’est là que vous sursautez. Que le récit devient captivant.
Il explique qu’en 2009, un reportage sur ABC évoquait les enfants des Appalaches et leurs graves problèmes dentaires, liés à une consommation excessive de sucre chez ces gens-là. La plupart des hillbillys se sont plaint qu’on donne d’eux cette image « insultante ». Le type s’en souvient car sa cousine avait posté un message sur Facebook, répondant à ces critiques que « reconnaître les problèmes de la région est la seule façon de les résoudre ».
Pour soigner un mal, encore faut-il le regarder en face et correctement le nommer.
« Avoir une image honnête de soi-même » c’est affronter des vérités et des responsabilités. Etre pauvre est une chose, avaler des tonnes de sucre chaque jour en est une autre, et l’un n’entraîne pas automatiquement l’autre. L’un pourrait ne pas entraîner l’autre.
Wouah. La franchise de ce type, cette capacité tranquille à énoncer des vérités devenues si dangereuses, si socialement incorrectes ! Un vent frais, revigorant.
Pas d’effet de registre dans son récit, pas de lyrisme. Honnêteté et rigueur intellectuelles tiennent lieu de style, puissant. Les mots simples sonnent longtemps : responsabilité, travailler, mériter, aider. Ceux qu’on n’ose plus employer de crainte d’être traité de réac. Ceux qui provoquent la réponse gênée : « on ne peut pas dire les choses comme ça, c’est plus compliqué que ça ».
Eh bien ce type vous raconte les choses comme ça. Franchement et simplement.
Etre curieux de ceux qu’on aime, c’est se pencher sur eux (et donc sur soi) sans tabou. Et dire ce qu’on voit, de beau et de moche, de justifié et d’injustifiable.
Avec ce fichu bon sens largement oublié par ceux qui dirigent le monde en surplomb.
Ainsi du débat sur les vertus du talent et du travail :
« Pour le Middletownien moyen, travailler dur pèse moins lourd que le talent brut.
Cela ne signifie pas que les parents et les enseignants ne soulignent jamais l’importance du travail. Ces comportements flottent juste sous la surface, moins dans les paroles que dans leurs actes. L’une de nos voisines a bénéficié d’aides sociales pendant toute sa vie mais, quand elle ne demandait pas à emprunter la voiture de ma grand-mère ou qu’elle n’échangeait pas des tickets alimentaires contre des espèces (avec une marge), elle ne cessait de vanter les mérites du travail acharné. ‘Y a tellement de gens qui profitent du système, affirmait – elle, que ceux qui travaillent dur ne peuvent plus percevoir l’aide qu’ils méritent.’ Telle était la fiction qu’elle s’était créée au fil des années : les bénéficiaires du système étaient pour la plupart d’incroyables sangsues ; elle qui n’avait pas travaillé un seul jour de sa vie était bien sûr une exception. »
Voilà une autre surprise : ce type détaille l’idée fausse que les hillbillys se font d’eux-mêmes.
Oui, ils démarrent avec des handicaps, à cause du peu de boulot disponible, du manque d’études et de moyens. Mais la marge de manœuvre possible, ils ne la prennent pas. Ils semblent au contraire revendiquer leur mouise, la travailler comme une identité, quand bien même ils vérifieraient chaque jour le lot de souffrances que cela entraîne.
Même retour à un bon sens actuellement inaudible à propos de la toxicomanie. Le type a vécu ça de près : outre les innombrables toxicos de son entourage « hillibyllien », sa mère (infirmière) est devenue accro aux opiacés et molécules anti-douleur. Un fléau américain de plus que nous avons niaisement copié.
A treize ans, il visite sa mère en centre de désintoxication, pour des réunions destinées à la famille. Il observe le cheminement psychologique qu’on lui fait suivre :
« Quand maman rentra à la maison quelques mois plus tard, elle apporta un nouveau vocabulaire. Elle citait fréquemment la prière de la Sérénité, un rituel des séances collectives, dans lesquelles le fidèle demande à Dieu de lui donner la sérénité d’accepter les choses qu’il ne peut pas changer. L’addiction aux drogues est une maladie, et tout comme je ne jugerais jamais un cancéreux parce qu’il a une tumeur, je ne devrais pas juger une droguée en raison de sa dépendance. A treize ans, je trouvais ça manifestement absurde, si bien que maman et moi nous disputions souvent sur la nature de cette nouvelle sagesse : était-ce une vérité scientifique ou l’excuse de ceux dont les choix ont détruit leur famille ?
Curieusement, c’était sans doute les deux : les recherches montrent qu’il existe une prédisposition génétique à l’abus de drogue ou d’alcool, mais aussi que ceux pour qui l’addiction est une maladie sont moins enclins à la combattre. Maman voyait la réalité en face, mais cette réalité ne la libérait pas. »
J’ai relu ce passage, incrédule. On a donc encore le droit de suggérer qu’une toxicomanie n’est pas une fatalité qui vous tombe dessus par déveine, mais le résultat d’un comportement, de mauvaises influences, auxquelles il est possible (on n’a pas dit simple) de se soustraire ?
Ce type n’est pas borné, ni binaire : il admet que la vérité est entre les deux.
Les toxicos, les obèses, les alcooliques ne sont pas nés ainsi, mais le sont devenus « à l’insu de leur plein gré », dans des environnements favorisant cette pente. Mais parler de maladie comme d’un diagnostic injuste, cela permet d’éviter de juger, et réduit toute responsabilité, toute causalité sur laquelle on aurait pu prendre la main.
Personne n’est responsable, c’est juste la faute à pas de chance….
Ce type a porté et supporté une mère toxico, et il dit tout bonnement que ce n’est pas une bonne idée de déresponsabiliser les gens dépendants.
Essayez donc ce discours par chez nous, auprès de vos amis qui se disent pleins de « valeurs »…
Ce type aime les siens, et ne réussira jamais à tout à fait s’en affranchir. Il ne le peut ni ne le veut. Mais si les ploucs ont mille difficultés, ce qui les plombe est qu’ils s’y installent si facilement, et nient leur part – même secondaire – de responsabilité.
S’ils se nourrissent mal, sont en mauvaise santé, accros aux médocs et à l’alcool, sans job, c’est la faute à l’Etat, aux patrons, au karma. Jamais la faute de leurs parents, qui leur ont appris à tromper les aides sociales pour s’acheter alcool et téléphones portables, quand ceux qui triment sans triche ne peuvent s’offrir ce superflu.
Le type cite un prof de son lycée :
« Ils veulent que nous soyons les bergers de ces enfants. Mais personne n’ose dire que beaucoup d’entre eux sont élevés par des loups. »
Ce type a souvent pensé que le gouvernement n’aidait pas assez les pauvres, mais aussi qu’en voulant aider, il ne faisait qu’aggraver la situation, encourageant finalement le déclassement, comme cela a été analysé s’agissant de la communauté Noire. Et il admet sans barguigner ce qui cloche dans beaucoup de familles hillbillys, et que les aides financières ne font qu’aggraver :
« Nous créons notre propre pauvreté en achetant des téléviseurs géants et des Ipad. Nos enfants sont bien habillés grâce à des crédits à la consommation aux taux d’intérêts stratosphériques et à des prêts à très court terme. Nous achetons des maisons trop grandes pour nous, achats que nous refinançons au prix fort, puis, ne pouvant plus rembourser notre emprunt, nous les quittons en laissant derrière nous une vraie décharge.
(…) Nous choisissons de ne pas travailler alors qu’il le faudrait.
(…) Nous parlons à nos enfants de responsabilité, mais nous ne joignons jamais le geste à la parole.
(…) Nos habitudes alimentaires et notre manque d’exercice physique nous destinent à une mort précoce, inexorable. »
Ce type parle au nom des Blancs.
On se prend à rêver : Bon sang, si chaque communauté avait la même honnêteté sur elle-même… !
Le type s’en est aussi sorti par ce choix judicieux, – soufflé par une cousine – de passer quelques années à l’armée. La vie familiale lui avait enseigné «l’impuissance acquise » : la certitude que « les choix n’ont pas d’effet sur les résultats obtenus ». Tout à coup, à l’armée, il fait la découverte extraordinaire du « pouvoir de la volonté », et comprend qu’il ne faut pas confondre «incapacité et efforts insuffisants ».
Oh que c’est moral.
Oh que c’est une vision exigeante et responsable de l’humain.
Mais comme ça fait du bien, comme ça sonne juste, clair, solide !
Et paradoxalement, une vision bien plus égalitariste, fraternelle et ouverte que tous les discours prétendument « solidaires ». Car l’effort est un principe offert à chacun, d’où qu’il parte, et le vrai effort, soutenu et consistant, permet toujours un résultat, même modeste, matériel, mental, psychique ou les trois à la fois.
Un peu le contraire de l’actuel mantra à la mode en occident : « Venez comme vous êtes, rien n’est de votre faute, faites ce que vous pouvez et écoutez -vous. Si vous ne pouvez rien et que vous n’êtes qu’un boulet, pas grave, l’Etat s’occupe de tout : gamelle mensuelle de sucres rapides, dosette d’anxiolytique et vaccin anti-tout, smartphone et abonnement Netflix. De quoi se remplir le ventre et se vider la tête. »
Le livre se termine par la suggestion de mesures pour soutenir réellement les plus modestes – et non les tenir à bout de bras. Il rappelle qu’aux E.U., les Blancs ouvriers sont les plus défaitistes sur l’avenir de leurs enfants, bien plus que les Noirs ou les Latinos, moins méfiants avec l’idée de succès ou de progression. D’un humour impitoyable avec lui-même, le type fait la liste hilarante des codes sociaux qu’il a dû apprendre, comprendre. Il ne crache pas dessus, bien au contraire. Il a vite pigé que maîtriser un vocabulaire plus riche, distinguer le skaï du cuir, se nourrir de façon équilibrée et savoir s’habiller pour un entretien d’embauche n’est pas forcément con ni méprisable.
Ça permet tout simplement de vivre mieux, plus longtemps, d’obtenir de meilleurs jobs et de pouvoir expliquer ce qu’on ressent sans taper son interlocuteur.
Tentant, non ?
Venons-en à l’identité de ce type, l’auteur d’« hillbilly élégie » : J.D. Vance, authentique hillbilly, d’où l’immense crédibilité du propos, parfaitement autobiographique.
Vance est un quasi – inconnu lorsque le livre sort en 2016 aux Etats-Unis, et un inconnu total en France lors de la publication française en septembre 2017.
Aussi inconnu de nous que l’était Donald Trump.
Le livre est alors salué par la critique, toute la critique, aux E.U. et en France, à droite comme à gauche.
Deux mois après, en novembre 2017, Trump est élu président des E.-U., et dans un premier temps, cela légitime d’autant plus le propos de Vance :
Le Monde :
« …tableau sombre de la crise industrielle, du mépris de classe à l’égard des ouvriers, de leur abandon par les deux grands partis politiques, convertis au culte du libre-échange ».
Brice Couturier sur France Culture (septembre 17)
« …livre hors du commun, salué avec un bel ensemble par la presse intellectuelle américaine, tant du côté conservateur que du côté libéral.
Il donne les clefs d’un facteur décisif ayant entraîné la victoire de Trump : le basculement de son côté de ces petits blancs, électeurs des Etats ravagés par le démantèlement des vieilles industries : Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, Ohio, ce qui reste de la Rust Belt.
C’est un livre d’une rare honnêteté intellectuelle, écrit depuis l’autre côté de la rive : son auteur, J.D. Vance s’est extrait de son milieu d’origine. C’est un livre âpre, lucide, sans complaisance, écrit par un homme qui garde une grande tendresse pour sa « communauté » d’origine. »
Nathalie Crom dans Télérama (septembre 17):
« TTT – Apre récit, qui décrit de l’intérieur, à travers le cas particulier de sa famille, l’existence quotidienne des populations défavorisées. Et s’attache toujours à souligner, au-delà des difficultés économiques, leur impact moral et spirituel qui se transmet de génération en génération : la déréliction en héritage. ».
Le roman sort en poche en France en septembre 2018, avec en bandeau un extrait du papier de l’Humanité : « Portrait d’une Amérique délaissée, celle qui a voté Trump.».
Comprenez : cette pauvre Amérique qui s’est trompée et a mal voté, mais on lui pardonne car elle souffre.
Vance publie son livre à 32 ans, et son propos « cash » attire l’attention des politiques.
Il s’engage en 2021 au sein des Républicains, se déclarant d’abord – brièvement – anti-Trump.
Il est élu sénateur de l’Ohio en 2022, avec cette fois le soutien de Trump.
A l’été 2024, le monde entier a appris que J.D. Vance était choisi par Trump comme colistier (Vice-Président en cas de victoire) dans la campagne qui l’oppose à K Harris pour la présidentielle de novembre.
Patatras.
Plus un mot sur le livre.
Plus question de louer l’honnêteté, la rigueur morale de Vance, ses origines modestes et la sorte d’expertise que cela lui donne.
J.D. Vance est désormais un vilain, un méchant. Croyez-le puisque Wikipédia vous le dit : c’est un « néoréactionnaire », « populiste de droite », « catholique pratiquant »….
La messe est dite, si je puis m’exprimer ainsi.
Je me disais, c’est bizarre : énoncer franchement certaines vérités difficiles est un geste unanimement salué, s’il est placé sous la bonne bannière politique. Sous une autre bannière, les mêmes vérités aussi incontournables, les mêmes évidences aussi criantes sont soudain déclarées parfaitement irrecevables.
Lisez Vance, écoutez ce type vous raconter ce qu’il a vécu, c’est un formidable roman intelligent et humaniste, vraiment intelligent et vraiment humaniste.
Ouvrage cité : Hillbilly élégie, J.D. Vance (Globe), 2017, (Le livre de poche, 2018).
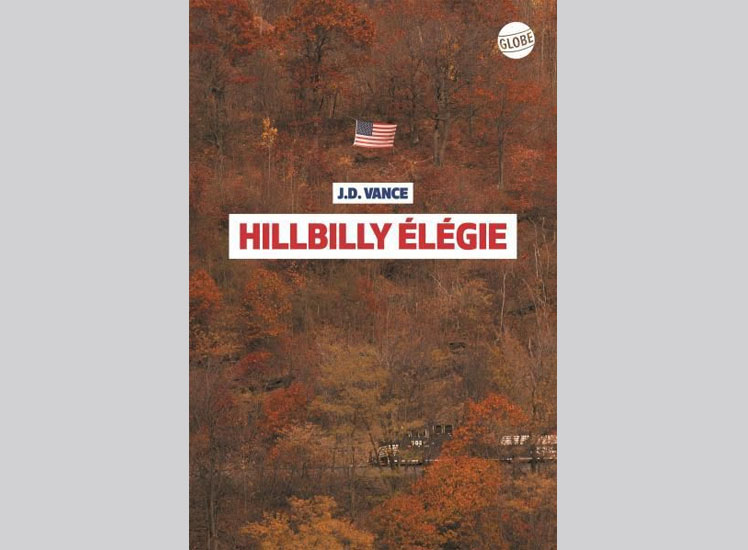
Laisser un commentaire