Originellement, le « chef d’œuvre » était l’ouvrage que devait produire un ouvrier-compagnon pour passer Maître dans sa discipline. Une pièce exceptionnelle, donc, permettant de démontrer le brio, la capacité à sublimer toute difficulté technique.
Par extension, un tour de force, un sommet, une perfection.
Aujourd’hui en littérature, la complexité, le raffinement et l’ambition ne sont plus à la mode : il est de bon ton d’encenser les textes brefs, les registres ténus, l’écriture « blanche », « à l’os ». Chapitres courts terminant par un rebond accrocheur, dialogues concis, idées tranchées, vocabulaire réduit.
Les gens aiment – dit-on ! – ce qui est simple et efficace. Ils veulent piger chaque mot : surtout pas de phrases méandreuses, de paragraphes lyriques ou de nuances ambiguës. Les gens – dit-on ! – n’y comprendraient rien. Faut lisser, niveler, et que ça se vende…
D’où (peut-être ?) les commentaires récents navrants à propos de Jivago sur des sites type Sens Critique ou Babelio : le roman serait « confus » dans les 100 premières pages (mince, plus de trois personnages et une composition mosaïque, ouh lala c’est compliqué)… Télérama en 2023 trouve que c’est « un chef-d’œuvre exigeant »… (c’est-à-dire ? Exigeant de savoir lire ? c’est quoi un chef d’œuvre « pas exigeant »?)
Je me disais : C’est bizarre, Le roman de Pasternak ne répond à aucun des critères actuels, il est pourtant l’un des textes les plus puissants du 20ème siècle, assurément un chef-d’oeuvre.
C’est un texte mûri une vie entière (raison insuffisante, mais commençons par là).
Boris Pasternak aurait pris neuf ans pour rédiger ce roman. Ajoutons la maturation, ce chemin que le projet dans la psyché de l’auteur, tandis que ce dernier vaque, travaille, lit ses devanciers.
Fils d’un peintre professeur aux Beaux-Arts de Moscou et d’une pianiste confirmée, Pasternak grandit dans la compagnie quotidienne de tous les arts. Il côtoie Tolstoï, Rilke, Serov, parmi bien d’autres.
Devenu poète et traducteur, il accueille la révolution de 1917 avec intérêt et espoir. Il a toujours été sensible à la condition des modestes, des démunis.
En 1927, dans le récit « Sauf-conduit », il défend la nécessité de la poésie, vitale car apolitique, supérieure à toute idéologie et l’année suivante, il publie un long poème « Très haute maladie » empreint d’une ambiguïté douloureuse : comment rester poète dans un pays déchiré par le communisme de guerre ? Quelle poésie composer sans verser dans le mensonge ?
En 1932, l’épouse de Staline se suicide. Pasternak lui écrit un mot auquel le leader est sensible.
Entretemps l’écrivain a été d’abord déçu, puis horrifié par le dogmatisme brutal qu’implique la mise en œuvre de la théorie communiste. Ayant accepté une commande d’un texte à la gloire de la reconstruction socialiste dans l’Oural, il s’y rend avec sa femme. La misère et la ruine qu’il découvre l’horrifient au point qu’il renonce.
Pasternak a un projet de roman, mais il est censé respecter l’esprit de Parti, proposer des textes imprégnés de réalisme socialiste. Ne pas approuver bruyamment certaines arrestations ou procès est suspect. Se taire est subversif, et Pasternak se tait.
Quand Ossip Mandelstam est arrêté, Pasternak tente d’intercéder auprès de Staline, qui se prétend encore sensible à la cause littéraire. Ils échangent par téléphone quelques phrases ambiguës.
Début 1935, profondément abattu, Pasternak entre en maison de repos. Il en est extrait autoritairement pour représenter l’URSS au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, à Paris. Il en revient à moitié fou. Les pressions s’accentuent, des amis sont condamnés, se suicident. Lui-même est menacé d’arrestation pour individualisme.
Début 1936, il publie deux poèmes à la gloire de Staline. C’est son dernier effort, sa dernière compromission.
Effaré, écoeuré, Pasternak observe un Etat obsédé imposer une mythologie invivable, à coups de décrets obscurs, de réquisitions punitives, affamant un peuple épuisé.
En 1938, Boukharine est fusillé : Pasternak perd un ami et s’effondre un peu plus. Terré à Peredelkino, près de Moscou, il traduit Keats, Verlaine, Shelley puis Shakespeare (de ce dernier, on retrouvera dans Le docteur Jivago l’ampleur de récit, la poésie cosmologique, et le pathétique risible des leaders révolutionnaires, aussi terrifiants que certains rois d’Ecosse).
En 1941, Pasternak et sa famille sont évacués et enrôlés à Moscou dans la défense civile de la capitale, ce qui ne lui déplaît pas : il est resté patriote. Mais en 1946 les persécutions recommencent, sa maîtresse, Olga Ivinskaïa – une femme de caractère qui aurait inspiré la Lara de Jivago -, est arrêtée pour suspicion d’espionnage, incarcérée dans un camp où elle perd l’enfant qu’elle portait.
Pasternak se décide : il va décrire le monde tel qu’il est, et tant pis s’il est justement interdit de dire le vrai. Il ne peut plus faire autrement, il ne veut plus être l’Ecrivain Soviétique. Il lui faut s’émanciper des consignes, des théories, des doxas. Dire de quels éléments la vie est réellement composée : « l’eau, l’air, le désir d’être heureux, le terre et le ciel ».
Ce qu’aucun décret au monde ne peut contenir, ce qui ne peut se réduire à un programme politique, quel qu’il soit.
Il se lance dans la rédaction de Jivago : Un roman réaliste et cruel, mais aussi un chant à la gloire de la vie sur Terre, la seule qui nous soit offerte. Un roman pour combattre « un sentiment de malheur imminent, une conscience de son impuissance devant l’avenir, qui n’étaient dissipés ni par sa soif de justice, ni par sa disposition naturelle au bonheur », à l’instar du jeune Iouri au début de l’histoire. Pour rappeler que la condition humaine n’est pas fongible dans quelque programme politique que ce soit.
Pasternak raconte la vie de Iouri Jivago, depuis la mort de sa mère alors qu’il est enfant, jusqu’à son propre décès. Au début, il n’est qu’un personnage parmi d’autres, les chapitres formant un kaléidoscope, morceaux de puzzle s’ajustant peu à peu autour de lui, qui devient le centre. La magie de cette composition est de provoquer chez le lecteur la même surprise trouble que celle de Iouri lorsqu’il recroise tout à coup, au fil de sa vie, une connaissance lointaine, et comprend soudain quel rôle elle tient dans son destin.
Ainsi de Lara, d’abord entr’aperçue, qu’il retrouve en pleine tourmente, tandis qu’elle-même est mariée à un des leaders de la révolution. Lara suscite l’amour fou de Jivago, elle est son échappée impossible, celle qui fait vaciller son mariage – situation que Pasternak a bien connue.
Jivago n’est pas toujours héroïque, il se montre souvent fataliste, frôlant l’indifférence. Mais à plusieurs reprises, il tente de retrouver un peu de liberté au prix de terribles épreuves. Le récit elliptique de son évasion d’un camp est pourtant terrifiant : que reprocher à un homme qui a traversé le pays enneigé à pied, en haillons, pour échapper aux plus obtus de ses concitoyens ?
Pas de happy end : Pasternak est un Russe et ce qu’il a vécu l’a vacciné contre l’optimisme forcené. Il ne s’agit que de tentatives, de vivre, d’aimer, d’écrire, mais c’est là le plus important.
Quand Staline meurt en 1953, Pasternak y travaille encore, et mettra le point final en 1955.
L’histoire de ce roman est un autre roman : aucun éditeur n’en veut en Russie soviétique, il est donc publié en Italie, en 1957. Le retentissement du texte est aussitôt mondial, Pasternak devient – malgré lui – le symbole de la résistance au communisme.
En 1958, Gallimard publie la version française de quatre traducteurs : Jacqueline de Proyart, Hélène Zamoyska, Louis Martinez et Michel Aucouturier, dont il faut saluer le travail éblouissant, restés longtemps anonymes par prudence.
La CIA fait circuler le texte russe en Russie, intéressée par ce qu’elle estime être un propos contestataire. Toujours en 1958, l’Académie Nobel lui décerne son prix de littérature mais Pasternak sait que s’il quitte son pays, il n’y reviendra jamais. Il refuse le prix dans un message alambiqué qui sonne faux, puis abandonne ses droits d’auteur, mais cela ne freine pas la colère du pouvoir. Exclu de l’Union des écrivains, il ne reçoit plus de commandes de traduction, est privé de ressources, surveillé, menacé.
On reproche à Jivago d’être un héros petit-bourgeois, égoïste, traître au progrès et au peuple, qui de surcroît se réfère sans cesse au Christ. Toute la population serait indignée par le roman, « jusqu’aux chasseurs de baleines » – qui ne savent pourtant pas lire – comme le soulignera Ismaël Kadaré.
Pasternak meurt d’un cancer en 1960, à 70 ans, ruiné et boudé.
Il sera réhabilité en 1985, publié officiellement en Russie en 1988.
Puisse le ciel lui faire savoir le bonheur qu’il nous a offert.
Jetez un œil aux photos, voyez cette belle gueule d’amoureux boudeur, cette large bouche très fermée, ces yeux très ouverts au regard intense.
Ce livre évoque tout ce qu’il est donné à l’humain d’appréhender : les chagrins de l’enfance, la roue des saisons, la construction d’une vie dans le flux des crises et des guerres, le dialogue intime avec la peur, la joie, l’ambition, la foi ontologique. Tous les sentiments humains y vibrent, toutes les limites humaines s’y montrent, et la fragilité mortelle de tout un chacun, et l’immensité de l’univers, autour.
Il y est question du réel et ses angles coupants, mais aussi des manifestations de l’âme, de nos pauvres et puissantes illuminations.
Les personnages, nombreux, aux voix fortes et originales, forment une compagnie chorale qui finalement nous ressemble, nous trouve ici et maintenant; voilà le miracle.
Le cycle saisonnier est un personnage : il s’exprime, s’impose, contrarie ou accompagne, il faut composer avec. On croise l’automne, et sa « senteur piquante de pommes congelées, d’âcre sécheresse, d’humidité sucrée, mêlée aux vapeurs de septembre, bleues et entêtantes ».
L’hiver s’abat brutalement, s’installe comme pour toujours. Le givre, «papillonnant aux yeux, qui décorait la forêt d’un filigrane argent et noir », la neige, le vent et le froid cèdent pourtant subitement à la chaleur, la moiteur, aux déluges de pluie et de boue. Le dégel russe est un opéra tragi-comique.
L’eau est un autre protagoniste. Elle « s’en donne à cœur joie », la pluie. On la découvre, on n’en avait jamais connu des comme ça. Autre rencontre sidérante : les arbres. Magie d’une causerie avec la poussée végétale en personne, qui se tiendrait là devant nous, « la grande flamme verte de la feuillaison qui incendiait dans la forêt les premiers arbres réveillés. » Coude à coude avec les bouleaux qui « se raidissaient comme des martyrs, déchiquetés par les dents et les flèches de leurs feuilles qui éclataient. »
La lumière est un second rôle indispensable : celle d’octobre, « cette lumière crémeuse de l’automne doré qu’on voit briller après l’assomption, alors que les premiers gels craquent, le matin ».
Les senteurs de la forêt jouent le rôle d’un mage révélant à une jeune fille le sens de l’existence : « y voir clair dans la beauté forcenée de la terre et donner à toute chose un nom ».
Pasternak reprend la parole aux arbres et à la pluie pour plaider la terre nourricière, la ferme bien tenue, tout à la fois abri, paysage, lieu de travail et potager, université de tous les savoirs. En ces temps de mort programmée des agriculteurs, c’est une joie et un crève-cœur de lire : « Ils n’ont besoin de personne, ils savent ce qu’ils veulent, ce sont eux les patrons. Les fermes sur la grand-route sont toutes neuves, un vrai plaisir. Chacun a jusqu’à quinze arpents de terre ensemencée, de chevaux, des brebis, des vaches, des porcs. Du blé en réserve pour trois ans. Et cet équipement, une réjouissance. »
La nature sauve, émeut, accueille, cache au besoin, ensevelit parfois, comment imaginerait-on la supplanter ? Quelle entreprise humaine pourrait réellement s’affranchir de sa présence, de son emprise ?
Rampant dans la boue, la poussée révolutionnaire s’approche de page en page, s’enlise et se redresse, tue et prend des coups à son tour. Le bon docteur Jivago, et c’est bien ce qu’on lui reproche, observe le révolutionnaire-type comme n’importe quel autre patient.
La fièvre révolutionnaire est un diagnostic banal sous le stéthoscope de Pasternak.
Qu’il soit leader charismatique ou militant sans grade, le bolchévik n’impressionne pas Jivago. La révolution est une femme qui hurle et harangue, décide les autres, peu important à quoi, elle emporte le morceau. Là où rien ne bougeait, tout à coup tout remue :
« C’est le miracle de l’histoire, cette Révélation braillée en plein dans la vie de tous les jours, et sans égards pour elle. Ça ne commence pas au commencement, mais en plein milieu, sans délais fixés à l’avance, dans des jours semblables à tous les autres, alors que les tramways parcourent la ville.»
La révolution qui s’ébranle, « alors que les tramways parcourent la ville » ! Il n’y a que Pasternak pour trouver ce cadrage.
Cher Jivago, si patient face aux soulèvements, si peu dupe. Ni bolchéviste, ni légitimiste, fataliste. D’une cruelle lucidité, il analyse le terreau d’une révolution :
« Personne ne fait l’histoire, on ne la voit pas, pas plus qu’on ne voit l’herbe pousser. Les guerres, les révolutions, les tsars, les Robespierre sont ses ferments organiques, son levain. Les révolutions produisent des hommes d’action, des fanatiques munis d’œillère, des génies bornés. En quelques heures, en quelques jours, ils renversent le vieil ordre des choses. Les révolutionnaires durent des semaines, des années, puis, pendant des dizaines et des centaines d’années, on adore comme quelque chose de sacré cet esprit de médiocrité qui les a suscités. »
Quand Jivago rencontre un redouté général de l’Armée révolutionnaire, on dirait qu’il l’ausculte, le dissèque :
« Il était à tel point l’homme qu’il voulait être que tout en lui semblait exemplaire.
(…) Cet homme devait posséder un don, et qui n’était pas forcément original. Ce don, trahi par ses moindres mouvements, était peut-être le don d’imitation. A l’époque, on imitait toujours quelqu’un : les glorieux héros de l’histoire ; des figures entrevues au front ou dans les villes, les jours d’émeutes, et qui frappaient l’imagination ; les plus prestigieux représentants du peuple ; des camarades qui avaient réussi ; les autres, tout simplement. »
C’est ce qui s’appelle démythifier.
Pourtant Pasternak est sensible aux cruelles différences de destin, il sait que « des goinfres et des fainéants ont vécu sur le dos des travailleurs affamés, les ont opprimés à mort ».
Sans être dupe du « désir de justice », il a compris l’arrivée de la révolution. Mais après avoir bien regardé les gars à la manœuvre, il a déchanté. La révolution ? Quelques figures, beaucoup d’imitateurs, et derrière eux des troupes manipulées. Des gens qui « spontanément, haïssaient d’une haine bestiale les intellectuels, les seigneurs et les officiers », « véritable trésor pour les intellectuels de gauche enthousiastes qui leur attachaient un prix considérable. Leur manque d’humanité était présenté comme un modèle de fermeté révolutionnaire et d’instinct révolutionnaire. »
De Strelnikov, le grand leader sanguinaire, Jivago comprend qu’il veut surtout régler un vieux compte avec les « fils à papa, des dandys étudiants et fils de marchands, élégants en pantalon à sous-pied qui, la casquette de travers, emmenaient les petites filles en voiture découverte ».
Là-dessus, rien n’a changé…
La grande audace de Pasternak est de faire de Jivago un type révoltant de bon sens, qui affirme une chose simple : le vertige du projet révolutionnaire n’est rien à côté de la vie, la vraie, celle qui nécessite des aptitudes aussi inégalement réparties que le reste.
L’aptitude à être au monde. « L’homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre. » L’aptitude à recevoir le soleil à travers un feuillage, le bruit des cloches tordu par le vent, la joie d’aimer. Vivre : se mêler, se frotter, s’engueuler, s’entraider. Parfois avec les mêmes.
« Car c’est seulement dans la mauvaise littérature que les vivants sont divisés en deux camps et n’ont aucun point de contact. Dans la réalité, tout est tellement entremêlé ! Il faut être d’une irrémédiable nullité pour ne jouer qu’un seul rôle dans la vie, pour n’occuper qu’une seule et même place dans la société, pour signifier toujours la même chose ! »
Jivago aimerait simplement exercer la médecine et le soir, une fois femme et enfants couchés, écrire un peu. Une fois les patates arrachées, son travail fait, le dîner pris en famille.
Comme si ce n’était pas une vie, la plus haute, de se nourrir et nourrir les siens, de travailler, de mûrir des poèmes après avoir lu ceux de nos devanciers.
Mais des types ont promis au pays une révolution.
Promesse présomptueuse qui d’abord console les inaptes, les mal lotis et les amers, dont il ne reste à la fin que le sang versé, la mort brutale, la faim et la peur pour presque tous, la peine infinie, tout un gâchis poisseux de petitesse. Exécutions, expéditions punitives, tortures pour l’exemple, pelotons à 12 contre 1, Pasternak sait de quoi il retourne.
L’amour de Jivago et Lara naît aussi de cette consternation qu’ils partagent :
« Les mièvreries humanitaires à la mode et l’adoration idolâtre de l’homme ne les attiraient pas. Les principes d’un culte menteur de la société transformé en politique leur semblaient médiocres et incompréhensibles, comme un bricolage misérable. »
Pire encore que les camps : le mensonge totalitaire. La folie normative. La fausse paix imposée par une vraie terreur. Pour ne pas avouer l’échec du système communautaire, on force les hommes à penser contre soi, « à voir ce qui n’existait pas et à prouver le contraire de l’évidence ».
On peut mourir pour un nouveau décret dont on n’a pas eu le temps de prendre connaissance, et les décrets se suivent et se ressemblent, absurdes, abscons, chacun défaisant le précédent au gré des victoires ou revers du parti révolutionnaire… Perquisitions, réquisitions, travaux obligatoires, travaux interdits, encadrés. Syndicats, comités, sections… Toute l’obscénité d’un vocabulaire qui tente de maquiller en patriotisme heureux « ces cris forcenés et ces exigences immuables à longueur d’années, de plus en plus irréelles, immuables et inapplicables ».
Devant un énième décret sur des perquisitions de blé menaçant tout spéculateur d’exécution sommaire, Jivago songe :
« De quel blé s’agit-il, alors qu’il y a longtemps que le blé ne pousse plus ? Quelles classes possédantes, quels spéculateurs, alors que les décrets antérieurs impliquent qu’ils sont anéantis depuis longtemps ? Quels paysans, quels villages, quand ils n’existent plus ? Comme ils oublient leurs propres mesures, leurs propres décisions qui ont tout anéanti depuis longtemps ! Comment peut-on divaguer de années de suite, avec cette fièvre qui ne se refroidit pas, sur des sujets inexistants, depuis longtemps épuisés, et ne rien savoir, ne rien voir autour de soi ! »
(Je me pose souvent les mêmes questions devant le « décret » du jour, l’énième nouvelle norme européenne, projet de loi, plan de lutte, réglementation, obligation vaccinale, j’en passe.)
Tout ça rend fou, au point de préférer la guerre, la vraie : « la réalité de ses horreurs, du danger qu’elle nous faisait courir, de la mort dont elle nous menaçait, a été un bien auprès de la domination inhumaine de l’imaginaire ; elle nous a apporté un soulagement parce qu’elle limitait le pouvoir magique de la lettre morte. »
Faut-il vivre un martyre pour se réjouir que la guerre éclate !
Pasternak a vu ses amis purger des peines, revenir d’exil, réciter leur leçon, expliquer que les conversations avec le juge d’instruction les avaient dessillés, qu’ils avaient mûri, compris des choses…
« Un homme enchaîné idéalise toujours son esclavage. C’était ainsi au moyen-âge. Iouri ne pouvait supporter ce mysticisme politique des intellectuels soviétiques, ce qui était leur plus grande réussite, leur conquête, ou encore, comme on aurait dit alors, le plafond spirituel de l’époque. »
Comme il est seul, le clairvoyant, parmi la foule aveuglée.
Pasternak ouvre la porte à autre chose, une transcendance, une façon d’être au monde.
« Transformer la vie ! Ceux qui parlent ainsi en ont peut-être vu de toutes les couleurs, mais la vie, ils n’ont jamais vu ce que c’était, ils n’en ont jamais senti le souffle, l’âme. L’existence pour eux, c’est une poignée de matière brute qui n’a pas été ennoblie par leur contact et qui attend d’être travaillée par eux. Mais la vie n’est pas une matière ni un matériau. La vie, si vous voulez le savoir, n’a pas besoin d’eux pour se renouveler et refaçonner sans cesse, pour se refaire et se transformer éternellement. Elle est à cent lieues au-dessus de toutes les théories obtuses que vous et moi pouvons faire à son sujet. »
Ainsi parle Jivago/Pasternak.
Quoi d’autre ? La foi. Un Dieu, peut-être, l’idée d’un Dieu. Pourtant né dans une famille juive non pratiquante, Pasternak ouvre son cœur au christianisme alors interdit, maudit, moqué.
Peu après Pâques, dans l’abbaye Saint-Victor de Marseille, mes yeux sont tombés sur ce verset des Apôtres :
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l’un quelconque de ses biens ; au contraire, ils mettaient tout en commun. »
La première communauté de croyants vivait en martyrs, prêts à donner leur vie pour témoigner de la parole de Jésus. Les premiers communistes étaient des non-violents.
Dans Jivago, la vieille Ouistina qui passe pour demie folle fait remarquer à un camarade commissaire :
« … je vous ai écouté, et vous ne savez que radoter sur les bolchéviks et les mencheviks. Bolcheviks, mencheviks, vous ne connaissez que ça. Mais ne plus faire la guerre et être frères, c’est la loi du bon Dieu, ça, et pas celle des mencheviks, et donner les fabriques et les usines aux pauvres, c’est pas les bolcheviks, c’est la pitié humaine. »
Que Pasternak ait été croyant ou non, il s’émeut en tout cas du message chrétien :
« Une jeune fille enfante, non parce qu’elle ne peut pas faire autrement, mais par miracle, par inspiration. C’est sur cette même inspiration que l’Evangile, qui oppose l’exceptionnel et l’ordinaire, les jours de fête et les jours de travail, veut construire la vie, à l’encontre de toute contrainte.
Quelle importance immense dans ce changement ! Comment cette affaire humaine d’ordre privé, affaire infime du point de vue de l’antiquité, a-t-elle pu acquérir aux yeux du ciel (…) une valeur égale à la transmigration de tout un peuple ?
Quelque chose s’est mis en mouvement dans le monde.
Rome est morte. Morte la puissance du nombre, la nécessité imposée par les armes, de vivre comme tout un peuple. Les chefs et les peuples appartiennent désormais au passé.
La personnalité, la prédication de la liberté les ont remplacés. La vie humaine individuelle est devenue l’histoire de Dieu, elle a rempli de son contenu l’étendue de l’univers. »
Pauvre Pasternak, s’il voyait l’état actuel du monde.
Autre caractéristique du chef d’œuvre : la modernité (qui s’ignore). L’avance sur son temps.
Pasternak a réfléchi à l’aveuglement de l’amour, son parti-pris terrifiant : un homme amoureux est persuadé que l’objet de son cœur n’a été créé que pour lui être confié… Tout à coup, une femme devient son besoin vital, son adoration, et c’est un péril mortel auquel on ne peut presque rien. Car l’homme qui adore suppose que la femme est fragile, victime, de quoi il ne sait pas mais peu importe, il la protègera. La passion est de mauvaise foi, et l’homme le plus aimant peut pourtant abîmer son amour, mal l’aimer, ne la protéger de rien.
C’est ce que Pasternak raconte avec une troublante honnêteté, lui qui a eu deux épouses et au moins deux maîtresses.
Il est à mon sens le premier à décrire ce qu’aujourd’hui on appellerait un « syndrome post-traumatique » : la jeune Lara a été livrée très jeune à un homme mur. Il lui faisait horreur, son intimité lui faisait horreur, mais il lui évitait l’extrême pauvreté. Avec bonne foi, comme ça se faisait et se fera toujours, à tort ou à raison, cet homme puissant lui a ouvert des portes, a financé ses études. On devine qu’il lui a aussi ouvert son lit et imposé son désir.
Pasternak, sans attendre nos « écrivaines engagées », décrit les effets d’un viol sur une vie entière. Ayant tout compris du complexe mécanisme de gestion de la honte chez une femme violée, il nous montre Lara qui s’abîme, patauge, souffre sans comprendre. La violence la hante, et les pensées morbides, elle rêve de hache vengeresse, une partie d’elle est envahie, engloutie dans une faille profonde, secrète, indicible.
Pasternak pousse jusqu’à explorer l’ambiguïté d’une victime, ses possibles réactions contre-nature. Et pourquoi pas, puisqu’il a décidé de dire tout ce qui existe ?
Lorsque Jivago et Lara s’aperçoivent qu’ils ont été tous deux, de façon bien différente, victimes du même homme, Jivago déclare sa jalousie :
« -Voilà de qui je suis jaloux, jusqu’à la folie, irréparablement.
-Qu’est-ce que tu dis là ? Non seulement je ne l’aime pas, mais je le méprise !
-Te connaitrais-tu si bien et si à fond ? La nature humaine et surtout la nature féminine est si obscure et contradictoire. Par un certain repli de ton dégoût, peut-être lui es-tu plus profondément soumise qu’à n’importe qui d’autre que tu aimes de ton plein gré, sans contrainte.
-Comme c’est terrible, ce que tu viens de dire. Et, comme d’habitude, tu es tombé juste, et cette réaction contre nature me semble vraie. Mais alors, c’est effroyable…
-Calme-toi. Ne m’écoute pas. Je voulais dire que je suis jaloux de quelque chose d’obscur et d’inconscient avec quoi les explications sont impensables, et qu’on ne peut définir. Je suis jaloux des détails de ta toilette, des gouttes de sueur sur ta peau, des maladies contagieuses dont l’air est infecté, qui peuvent t’atteindre et empoisonner ton sang. Et je suis jaloux de Komarovski qui un jour t’enlèvera à moi, comme de la maladie, comme de la mort qui un jour nous séparera. Je sais, tout cela doit te paraître un amoncellement d’obscurités. Je n’arrive pas à m’exprimer de façon plus ordonnée, plus compréhensible. Je t’aime infiniment, à la folie, à en perdre la tête. »
Ça a une autre gueule que « Femmes, on vous croit », n’est-ce pas ?
Pourtant Lara vivra, et aimera, et travaillera, digne et active, car, nous dit Pasternak : tout comme face aux révolutions, aux guerres et autres drames, l’homme (ou la femme) est un feu toujours possible à ranimer, qui peut survivre au pire et n’attend que l’occasion d’espérer furieusement. Le plus dur est de vivre pleinement. Sans autre combat qu’ouvrir les bras à sa condition, même si la mort, indifférente, s’avance à notre rencontre, parfois un peu vite.
Quelle force ils mettent à s’aimer, ces deux-là ! On se prend à rêver d’être broyé par une révolution (je plaisante !), si c’est un écrin idéal pour vivre l’amour fou. Ecoutez la lucide Lara déclarer à Jivago :
« Toi et moi, nous sommes comme Adam et Eve qui au début du monde n’avaient rien pour se vêtir. Voici venir la fin du monde et nous n’avons guère plus de vêtements ni de foyer. Et nous sommes le dernier souvenir de tout ce qui a été infiniment grand, de tout ce qui s’est fait au monde pendant des millénaires qui se sont écoulés entre eux et nous et, en souvenir de ces merveilles disparues, nous respirons, nous aimons, nous pleurons, nous nous cramponnons l’un à l’autre, nous nous serrons l’un contre l’autre. »
(Je vous laisse le temps de vous moucher).
Comme si tout ça ne suffisait pas, Pasternak sculpte une immense rosace sur la façade de sa cathédrale, vitrail multicolore sublimant le moindre jour : il parle de l’envie d’écrire. Par touches plus larges à mesure que le roman avance, il révèle ce qu’est le besoin d’écrire, de traduire en mots ce qu’on perçoit du monde. Cette nécessité dans ce qu’elle a de plus intime, de fugitif et d’impérieux, d’insaisissable. La transformation d’une mystérieuse bouffée mentale, sa réduction en phrases qu’il faut tailler, bâtir – crayon, papier, solitude reliée à l’univers, temps aboli.
On a beaucoup dit que Tolstoï et son Guerre et paix (1865) avaient inspiré Pasternak. Ce qui appartient à Pasternak seul, c’est cette liberté suprême qu’il s’offre d’écrire sur le fait d’écrire, et se montrer à la tâche par le truchement de Jivago.
A bout de force, Jivago garde le projet d’écrire. Tandis qu’il se cache avec Lara dans une maison abandonnée, au cœur de la forêt sibérienne, en plein hiver, c’est ce qui le tient debout, donne forme à son for intérieur. Et ce qu’il voudrait réussir à faire, liberté dans la liberté, ce sont des poèmes. Dieu c’est si c’est compliqué, la poésie.
Nous le voyons se battre avec la matière qui permet la plus précise mise en forme d’un état d’âme : les mots. Le langage, qui « se met à penser et à parler pour l’homme, et devient tout entier musique, non par sa résonance extérieure et sensible, mais par l’impétuosité et la puissance de son mouvement intérieur. »
Nous sommes avec lui lorsque l’envie monte en lui, vitale au milieu du chaos. Nous le voyons organiser ses journées, sauver un reliquat d’énergie. S’y mettre. Comme chaque personne qui écrit, commencer par relire et arranger ce qu’il a couché la veille sur le papier. Entrer en état d’écriture, composer un poème, en être mécontent le lendemain. Biffer, réécrire, rayer, bailler et se tortiller sur sa chaise, tenter encore de convertir en des vers « ce qui fumait encore et n’avait pas refroidi ».
Et comme les poèmes sont là, en fin de livre, comme des photos de miraculés, nous pouvons, un doigt glissé en marque-page, aller en lire un ou deux par-dessus l’épaule de Jivago… ou de Pasternak.
Ne pas s’opposer au communisme, non. Bien plus ambitieux : le transcender, l’enjamber par la poésie.
A propos de mots : la nouvelle traduction d’Hélène Henry, publiée en 2023, était-elle nécessaire ? Non.
Ni la poésie, ni l’authenticité des dialogues, ni la précision de pensée, ni les données informatives d’une scène n’y gagnent… Rien qu’une variante un peu refroidie, un presque-équivalent légèrement moins intense. Verbes plus contemporains, adverbes ajoutés, formules « actualisées », comme une pincée de précision saupoudrée sur chaque page.
Pourquoi ? Parce qu’on ne comprendrait pas tout dans la première version, plus bouillonnante, énervée, à fleur de sens ? Parce qu’elle contient des termes moins usités aujourd’hui ? Et alors ? Pourquoi récrire en registre 2023 un texte signé en 1958 ?
Au contraire ! Ce registre particulier, cette langue pulsatile, ces phrases taillées à l’opinel dans un bois précieux formaient un pont pour rejoindre l’âme russe, la poésie tourmentée de Pasternak, la brutalité de l’histoire, l’incohérence des temps.
Encore et toujours le manque de confiance dans le lecteur, l’obsession de poncer, arrondir, aplanir jusqu’à lui servir une bouillie. A ne jamais se servir de ses dents, on les perd. Pour la cervelle c’est pareil.
« Oui mais des fois, faut chercher un mot dans le dictionnaire ! »
Et alors ? Le Littré ou le Robert sont en ligne, gratuits. Un coup d’oeil pour vérifier et tout à coup la phrase s’ouvre, le paragraphe s’éclaire et un paysage mystérieux se configure au fond de notre coeur. Sans contresens.
« Oui mais on aura oublié le mot une heure plus tard ! »
Pas grave. C’est l’instant de lecture qui compte. Aucune interro à la fin.
Pasternak maitrisait parfaitement le français, et avait trouvé la première traduction « céleste, géniale » ; je suis bien d’accord.
Un exemple parmi cent :
« Dans le jardin, le taffetas de cette nuit d’hiver finissant était réchauffé par le violet sombre, ardent, qui émane de la terre à l’approche du printemps. Dans la chambre, on retrouvait à peu près la même alliance : les rideaux mal battus semblaient moins poussiéreux, moins étouffants, dans la chaleur violet sombre de la fête imminente. »
Emotion devant le « taffetas de cette nuit d’hiver », ces « rideaux mal battus » – geste perdu, tissu oublié. On sent l’odeur d’une épaisseur un peu âcre, on est troublé par le contradictoire et énigmatique « violet sombre de la fête imminente ». Mais on s’en débrouille, bon sang, notre cerveau s’en débrouille ! C’est même là que tout commence : à l’instant où les mots nous pénètrent, embaumant l’atmosphère dans laquelle nous entrons de toute notre peau. Et si certaines formules flottent dans notre esprit indécis, c’est tant mieux : on vient de poser le pied dans une chambre intrigante.
Voici la nouvelle version :
« L’obscurité soyeuse de la nuit de la fin d’hiver se réchauffait de la première ardeur, mauve et noire, du printemps, qui pointait à travers la terre du jardin. Dans la chambre aussi, deux principes s’alliaient, la touffeur poussiéreuse des rideaux mal battus, adoucie et embellie par la chaleur sombrement violette de la fête proche. »
« Deux principes s’alliaient »… un vrai cours de physique-chimie ! « L’alliance » tout court, n’était-ce pas une évocation plus légère, pleine de tact ? On a gagné des virgules lourdingues et des précisions dont on se fout, on a perdu le taffetas de la nuit d’hiver, formule frémissante comme une floraison fragile.
Dieu est dans les détails.
Un petit dernier ? A propos de la Vierge Marie, une femme explique à Lara :
« Cette maternité est un scandale, et pas seulement parce qu’elle est illégale aux yeux des scribes : elle en est contradiction avec les lois de la nature. »
Ce qui devient :
«Ses couches sont illicites, non seulement au regard des doctes, puisqu’elles ont lieu en dehors du mariage. Mais elles contreviennent aux lois de la nature.»
Des « couches illicites » ! Au lieu du biblique et merveilleux « scandale » ! Encore une virgule de gagnée, et tout l’allant de la phrase, tout son balancé est perdu.
« Dieu qu’ils étaient lourds ! » disait Céline….
S’agissant des poèmes de Jivago, ce n’est pas plus heureux. Poèmes naïvement douloureux, modestes et immenses, aplatis par une précision matérielle inutile :
« Seule, en manteau d’automne / Nu-tête et en chaussons / Luttant avec ton trouble / Et mâchant des flocons. »
Devient :
« En paletot, nu-tête / Et en minces souliers /Tu mâches de la neige / Et combats ton émoi. »
Si le but était de relancer le roman, pourquoi pas.
Mieux vaudrait remettre la première traduction au programme du Bac, toutes filières confondues. En entier, avec toutes ses pages. Chiche !
La rencontre avec un chef-d’œuvre devrait être un droit garanti par la Constitution. Entrer dans un édifice de mots, passer des heures, des jours dans un monde tenu entre nos mains. Phrases imprimées, pages cousues, univers pourtant mouvant, émouvant, complexe, unique, légèrement différent à chaque visite.
Relever les yeux sur notre monde. Y voir un peu plus clair.
Ouvrages cités :
Le docteur Jivago, Boris Pasternak (Gallimard 1958, et poche Folio, et Gallimard nouvelle traduction 2023)
Le dossier de l’affaire Pasternak, collectif : archives du Comité central et du Politburo (Gallimard, collection témoins, 1994)
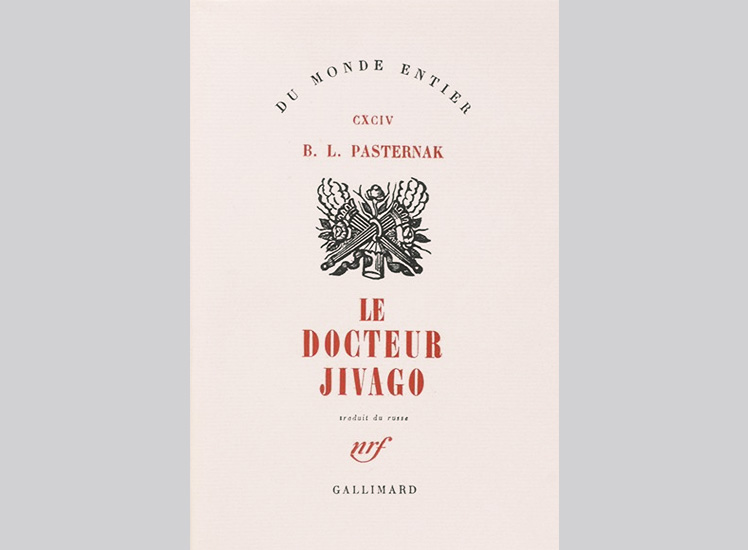
Laisser un commentaire